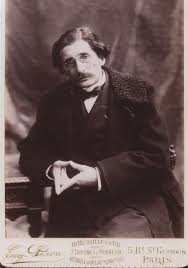Les cinq derniers articles
La fête de l'aéromodélisme aura bien lieu le 5 octobre.
SAINT PARDOUX & VIELVIC
À l'aérodrome belvésois du Camp de César

Photo © Section aéromodélisme de l'aéroclub de Belvès Périgord

Origine, formation et évolution des noms de personnes, par le majoral Jean-Claude Dugros
PAYS de BELVÈS
 |
Qui est Jean-Claude Dugros ? Ce cadre bancaire, aujourd'hui retraité, a obtenu un master 2 en occitan de l'université Montpellier-III. Il est devenu enseignant de cette langue en 1998. Vice-président du Bournat du Périgord et responsable de sa revue Lo Bornat. Il anime l'émission Univers occitan sur Radio Orion, puis Parlem nostra lenga sur Grand R. Il adhère au Félibrige en 1988. Maître d'œuvre en 2005, il est élu majoral, l'année suivante, à la tête de la cigale de Nîmes précédemment détenue par Louis Dejean. Également membre de l'Académie du Périgord, il est lauréat de l'Académie des jeux floraux en 2002 et en 2005. Wikipédia |
Jean Claude Dugros, Majoral du Félibrige et animateur d’ateliers d’occitan, en charge de la revue " Paraulas de Novelum ", est spécialiste de toponymie et traducteur. Il a travaillé sur le livre de Bernard Lesfargues " Chant de la vielle ", nouvelle anthologie de l'écrit en occitan du Bergeracois.
Il y a une dizaine d'années, il a traduit en occitan " L'ennemi de la mort ", un des ouvrages majeurs d'Eugène Le Roy. D'aucuns ont estimé que, bien qu'il transposa son œuvre dans la forêt de la Double, le romancier, écorché vif, retraçant les péripéties du Dr Charbonnière, là, jetait un embryon voilé d'autobiographie.
Ce samedi 27 septembre, à 17 h, au 5 av Paul Crampel, à la salle de l'A.B.C, le majoral Jean-Claude Dugros, répondant à l'invitation de Gilles Heyraud, président de l'Association belvésoise de la culture, dissertera sur l'origine, la formation et l'évolution des noms de personnes.
Si votre patronyme est courant, par exemple Bouyssou ou Roque, vous ne vous posez sans doute pas de question. Il n'en va pas de même quand ceux-ci, a priori, ne s'apparentent pas aux noms où l'on devine une traçabilité occitane. Attention aux faux-amis, Jean Rigouste, l'expert en onomastique, il y a une douzaine d'années, à Saint Amand, a profondément surpris en disant que les patronymes et toponymes Cantegrel et Cantelauzel, dont l'origine est fort lointaine et antérieure à l'occitan, ne collent pas avec la réappropriation paysanne de nos contrées.
Le celte et l'antique culture gauloise ont connu des apports multiples, hébraïques, arabes, vieux-norrois, germaniques et tout ce que l'on maîtrise fort peu, voire pas du tout, que les linguistes définissent comme indo-européen.
C'est donc une promenade dans toutes ces pistes que Jean-Claude Dugros va explorer avec le public, ce samedi.
Cet échange avec Jean-Claude Dugros ne se limitera pas au Pays de Belvès. Le conférencier peut largement déborder, notamment sur les communes du Pays nauzérois. Il répondra en direct ; cependant, si vous voulez, pour lui permettre d'effectuer des recherches plus approfondies, n'hésitez pas à lui poser vos questions en usant de la fenêtre commentaire.
P.F
Et oui, aujourd'hui, nous basculons de Fructidor à Vendémiaire... et c'est l'automne.

Un cèpe découvert, fortuitement, le 18 septembre 2025, au bord d'un chemin rural. Le cèpe est le bijou sylvestre qui choisit de préférence août ou (et) septembre pour émerveiller les mycologues et bien des promeneurs.
Photo © Pierre Fabre
Comme l'indique le calendrier de l'IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) de l'Observatoire de Paris, l'automne a lieu, cette année, le 22 septembre 2025 à 20 h 19, heure française.
Dommage ! "
Cette observation, certes, incontournable ne tient pas compte de la période calendaire de l'équinoxe qui, au même moment, s'approche de l'égalité pour les deux hémisphères. Cette notion d'égalité, l'égalité -utopique, certes- s'inscrit gravée dans la devise de la République, peut tout de même sembler une approche fort sympathique et ce fut un plus d'avoir initialisé le calendrier républicain l'An I de la grande Révolution, un jour d'équinoxe, jour où se dessine l'égalité des jours et des nuits.
L'équinoxe, avec des écarts symboliques dus à la rotation de la Terre, s'impose à Zuydcoote, à Bonifacio, à Wellington et à Nouméa.
Ce 23 septembre, le jour commence à Siorac-en-Périgord à 07:42:21 pour s'achever 12h 12m 28s plus tard, à 19:54:49
Les Nouméens pointeront le jour à 5h42'29" pour le voir disparaître 12h 8'53" plus tard, à 17h51'22". L'écart théorique est donc seulement de 3'35"
|
Notons que l'égalité parfaite sera atteinte, cette année, le 26 septembre dans l'humble village de Sergeac. Ce bourg proche des Eyzies chevauche le 45ème parallèle.
Le jour commencera à 7h46'24" et s'effacera à 19h47'12".
|
P.F
Une remarquable initiative dans la ville de La Boétie pour les Journées du Patrimoine
SARLAT-la-CANÉDA
CLIQUEZ SUR LES IMAGES
Le Palais de Justice de Sarlat
Image © Structurae. Base de données et galerie internationale d'ouvrages d'art et de génie civil.
Notre pays n'était pas encore en république… ou ne l'était plus depuis le coup d'état du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte. La famille Bonaparte, une fois encore, après le 18 Brumaire de l'An VIII [samedi 9 novembre 1799], témoigna son aversion pour la République, dont la deuxième version fut proclamée le 24 février 1848, et voulut imposer sa vision impériale.
L'actuel tribunal remplaça la maison du Présidial, l'ancien tribunal de justice créé au XVIIéme siècle à Sarlat. Le présidial, fondé lors de l'ère d'Henri II, fut l'ancien siège de la justice royale à Sarlat. Sa première existence fut éphémère. La sénéchaussée sarladaise fut en dualité avec celle de Périgueux. Cette "dualité" prit fin en 1641.
On notera que l'institution du présidial, instrument de la justice royale, est créée en 1552, confirmée par un édit royal en 1640, fonctionna jusqu'à la Révolution française. Le présidial va permettre l'ascension sociale de nombreuses familles patriciennes par le biais des offices.
_________________________
Une excellente idée pour l'accompagnement des journées patrimoniales.
On peut imaginer que de l'idée à la réalisation, il y avait beaucoup d'objections, voire de résistance, à affronter. Sénèque dans sa lettre à lettre à Lucilius soutint "Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt", soit " Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas, qu'elles sont difficiles". Marc Pinta-Touret a osé, le Théâtre de la Nauze est donc venu à Sarlat, ce vendredi 19 septembre ; et, dans l'émotion qui fut celle de ces comédiens habitués à la scène sagelacoise, avec quelques déplacements dans diverses localités, dont Siorac, St Cernin, Tamniès, Marquay et Le Buisson, se transportèrent à Sarlat pour parachever les 2 ans de travail sur scène de "Douze jurés en colère", leur dernière pièce.
Passons sur la séance dans la vaste salle du centre culturel. Elle fut, certes, une réussite devant un public attentif et conquis mais là ne fut pas le point d'orgue.
C'est au tribunal, transformé pour cette journée en lieu de dissertation et de réflexion de jurés statuant sur le cas d'un accusé, que les comédiens se sont éclatés. L'accusé plie sous la charge d'un jury qui admet la culpabilité... à l'exception du juré n° 8.
"Terre de l'homme", dans son billet du 14 novembre 2024, a présenté cette pièce.
https://terre-de-l-homme.blog4ever.com/theatre-de-la-nauze-douze-hommes-en-colere-1
La pièce Douze jurés en colère est la récriture de Douze Hommes en colère (Twelve Angry Men. Pierre Castets, pour le Théâtre de la Nauze, a retouché la pièce de théâtre œuvre de Reginald Rose écrite en 1954. Son auteur a lui-même été juré dans une affaire assez macabre. Par la suite la pièce Twelve Angry Men a été adaptée en français par André Obey, en 1958, et par Francis Lombrail en 2017.
Au cinéma Henri Fonda, en 1957, avec la classe qui le caractérisait, fut l'interprète majeur qui reste dans toutes les mémoires des cinéphiles. En 2025, sur l'autre côté de l'Atlantique, dans un petit village, 12 comédiens ont ferraillé sur le doute.
C'est cette pièce qui, après l'accueil de Marc Pinta-Touret, a été interprétée dans le Tribunal de Sarlat, le samedi 20 septembre. Les comédiens ont certainement été récompensés de leur travail opiniâtre par de chaleureuses salves d'applaudissements et rappels qui leur ont donné chaud au coeur.
Le doute s'est installé dans la conscience de la présidente du jury.
Non, ils n'en viendront pas aux mains. Cela serait un comble, là, tout près du prétoire.
Pleinement satisfaits et émus des rappels, les comédiens du Théâtre de la Nauze posent sur l'escalier du tribunal.
Photos © Bernard Malhache, Théâtre de la Nauze
Un petit détail qui mérite d'être ajouté. Le Théâtre de la Nauze, dont la qualité est notoire, a pour habitude de jouer bénévolement avec pour intention de soutenir la vie associative, vie scolaire ou Téléthon. Pour la première fois, ce collectif théâtral a obtenu, sans avoir mis la moindre pression, un cachet pour sa venue à Sarlat.
P.F